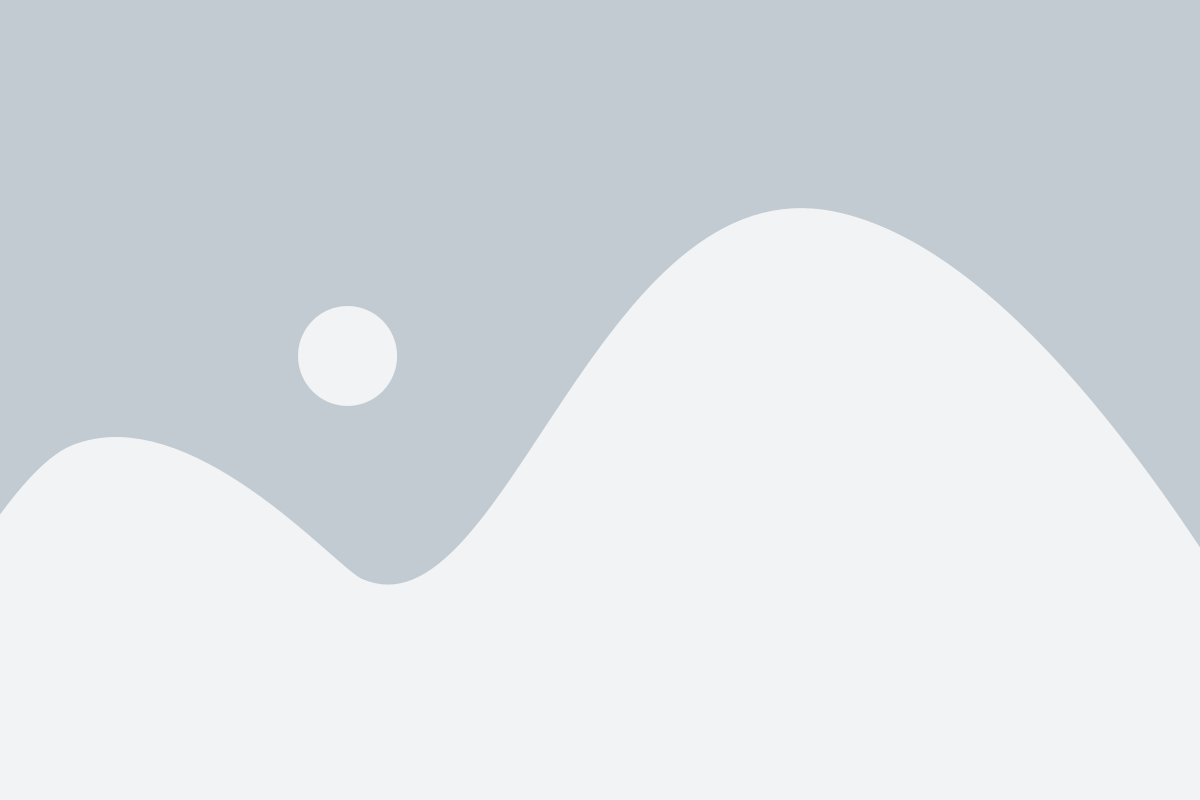Ces derniers jours, les États-Unis ont entamé un démantèlement majeur de l’USAID, l’agence responsable de l’administration de l’aide étrangère. De nombreux Américains célèbrent cela comme une victoire—enfin, plus de dollars des contribuables gaspillés pour des pays qui, selon eux, ne donnent rien en retour. Elon Musk, le milliardaire qui n’est arrivé aux États-Unis qu’à l’âge de 24 ans, est allé jusqu’à qualifier l’USAID d' »organisation criminelle », déclarant : « Il est temps qu’elle disparaisse. » Donald Trump a quant à lui qualifié les membres de l’agence de « fous radicaux ». Les adversaires des États-Unis, désireux de voir le pays se retirer de la scène mondiale, les ont applaudis. Mais les plus enthousiastes sont les Américains ordinaires, convaincus que leur pays a saigné de l’argent pendant trop longtemps pour des nations qui ne semblent rien offrir en retour.
C’est un récit tentant. Une phrase choc convaincante. L’idée que les États-Unis jettent simplement des milliards à des nations ingrates fait un bon théâtre politique. Mais si l’on gratte un peu, cet argument s’effondre. L’aide étrangère n’est pas une charité ; c’est une transaction commerciale, un outil diplomatique et une stratégie économique. Elle profite bien plus au donneur qu’au receveur. Le problème est que les citoyens ordinaires des pays donateurs, y compris les États-Unis, voient rarement comment ce système enrichit leur propre économie, soutient leurs industries et étend l’influence mondiale de leur pays.
L’aide étrangère a longtemps été un outil stratégique pour exercer une influence dans la diplomatie internationale. Le Plan Marshall, qui a vu les États-Unis injecter plus de 13 milliards de dollars (173 milliards de dollars actuels) en Europe après la Seconde Guerre mondiale, n’était pas simplement un acte de bienveillance. C’était un calcul visant à contrer l’influence soviétique et à solidifier le leadership américain dans le monde occidental. En reconstruisant les économies européennes, les États-Unis ont veillé à ce que leurs alliés restent stables et alignés sur leurs intérêts, créant ainsi des marchés lucratifs pour les produits américains.
Le même principe s’applique aujourd’hui. Les pays recevant l’aide américaine sont bien plus susceptibles de soutenir les politiques américaines dans les forums internationaux, d’accorder un accès militaire et de conclure des accords commerciaux favorables. En Afrique, par exemple, les programmes de l’USAID sont souvent assortis de conditions subtiles (ou pas si subtiles)—s’aligner sur Washington lors de votes clés aux Nations Unies, accepter certains partenariats militaires ou ouvrir les marchés aux entreprises américaines.
Sans ces programmes, les États-Unis perdent de leur influence. D’autres puissances mondiales, en particulier la Chine, sont plus que disposées à combler le vide. L’initiative « Belt and Road » de Pékin est une leçon magistrale sur l’utilisation de l’assistance économique comme outil de contrôle. La Chine finance des projets d’infrastructure à travers l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie, et en retour, ces nations s’endettent—à la fois financièrement et politiquement—auprès du gouvernement chinois.
Lorsque les États-Unis réduisent l’aide, ils ne « font pas des économies »—ils affaiblissent leur capacité à façonner les événements mondiaux, laissant la place à des concurrents qui comprennent la véritable valeur de l’influence économique.
Au-delà de la diplomatie, l’aide est un acteur crucial dans le commerce international. Une grande partie de l’argent alloué par l’USAID ne quitte jamais le sol américain. Au lieu de cela, il finance des industries américaines qui fournissent de la nourriture, des médicaments et des infrastructures aux nations en développement.
Prenons l’aide alimentaire, par exemple. Dans le cadre du programme américain « Food for Peace », les États-Unis donnent des surplus agricoles à des nations étrangères. Mais ce n’est pas simplement de la générosité—c’est un moyen de soutenir les agriculteurs américains. Le gouvernement achète l’excédent de céréales, de produits laitiers et d’autres produits aux agriculteurs américains à un prix fixe, puis l’envoie à l’étranger. Cela garantit que les agriculteurs nationaux restent rentables tout en inondant les marchés étrangers de produits américains.
Le piège ? Cette aide alimentaire concurrence souvent les agriculteurs locaux dans les pays bénéficiaires. Un agriculteur en difficulté en Haïti ou en Éthiopie ne peut pas rivaliser avec le blé américain gratuit. Avec le temps, cette dépendance affaiblit l’agriculture locale dans ces pays, les transformant en importateurs perpétuels de produits américains.
Il en va de même pour les produits pharmaceutiques. Une part importante de l’aide sanitaire américaine finance des entreprises pharmaceutiques américaines qui fabriquent et distribuent des vaccins, des médicaments antipaludiques et d’autres fournitures médicales. Ces entreprises reçoivent des contrats gouvernementaux garantis, assurant un flux de revenus stable. Réduire l’aide ne réduit pas seulement le soutien aux populations vulnérables—cela nuit aux entreprises américaines qui dépendent de ces contrats.
L’aide étrangère est également un important créateur d’emplois pour les Américains. Le budget de l’USAID finance un écosystème massif d’ONG, de sous-traitants privés et d’employés gouvernementaux qui conçoivent, mettent en œuvre et surveillent les programmes d’aide. Ce sont des emplois bien rémunérés pour des ingénieurs, des analystes politiques, des professionnels de la santé et des spécialistes du développement.
Un exemple classique est le Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR), qui a investi plus de 100 milliards de dollars pour combattre le VIH/sida à l’échelle mondiale. Bien que cette initiative ait sauvé des millions de vies, elle a également permis à des milliers de professionnels américains de rester employés dans les domaines de la santé publique, de la logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Ensuite, il y a les sous-traitants privés. Des entreprises comme Chemonics, DAI et John Snow Inc. gagnent des milliards en gérant des projets de l’USAID. Ces sociétés, basées à Washington D.C., emploient des milliers de travailleurs américains qui développent des infrastructures en Afrique, promeuvent le développement économique en Asie et supervisent des programmes de gouvernance en Amérique latine.
Réduire l’aide ne « fait pas économiser de l’argent aux contribuables »—cela met en péril des emplois américains et affaiblit des industries entières construites autour du développement international.
L’histoire offre un récit préventif sur ce qui se passe lorsque les États-Unis se replient sur eux-mêmes et abandonnent leur engagement économique à l’étranger. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont adopté une politique d’isolationnisme, refusant de s’impliquer dans les affaires européennes. Le résultat ? L’instabilité économique en Europe a contribué à l’émergence de régimes fascistes, aboutissant à la Seconde Guerre mondiale.
Comparez cela à la stratégie d’investissement et d’aide d’après la Seconde Guerre mondiale, qui a créé des alliés prospères et étendu l’influence économique américaine à travers le monde. L’Union européenne, l’OTAN et d’autres alliances mondiales existent en grande partie parce que les États-Unis ont compris que l’engagement économique et militaire à l’étranger était essentiel à leur propre sécurité et prospérité.
Ainsi, le 3 novembre 1961, lorsque le président John F. Kennedy, par le décret 10973, a consolidé divers programmes d’aide étrangère en une seule agence, l’objectif était clair : projeter l’influence américaine, stabiliser les alliés et contrer la propagation du communisme par l’aide économique et humanitaire.
Kennedy, dans son message spécial au Congrès sur l’aide étrangère, a présenté cet effort comme une nécessité stratégique, et non comme un acte de charité :
« Il n’y a pas d’échappatoire à nos obligations : nos obligations morales en tant que leader sage et bon voisin dans la communauté interdépendante des nations libres—nos obligations économiques en tant que peuple le plus riche dans un monde de personnes largement pauvres—et nos obligations politiques en tant que plus grand contrepoids aux adversaires de la liberté. Ne pas répondre à ces obligations maintenant serait désastreux ; et, à long terme, plus coûteux. »
Le timing n’était pas un hasard. L’Union soviétique injectait de l’argent dans les pays en développement, offrant une assistance économique avec des conditions idéologiques. Les États-Unis avaient besoin d’un contrepoids—quelque chose qui permettrait de sécuriser des alliés sans intervention militaire directe.
Les véritables bénéficiaires des réductions de l’aide américaine ne sont pas les contribuables américains, mais les concurrents des États-Unis. La Chine et la Russie sont désireuses de combler le vide laissé par le retrait américain, étendant leurs propres sphères d’influence tandis que les États-Unis se retirent. Pendant ce temps, les entreprises américaines qui ont construit leurs activités autour des contrats d’aide vont souffrir, et les travailleurs de ces industries se retrouveront sans emploi.
Les citoyens ordinaires qui applaudissent ces réductions le font parce que personne ne leur a expliqué les mécanismes cachés de l’aide étrangère. Ils ne voient pas que cela finance les emplois de leurs voisins, soutient les industries de leur pays et assure la domination mondiale de leur nation.
L’aide étrangère n’est pas un acte de charité—c’est une stratégie commerciale. Plus tôt les Américains le réaliseront, plus tôt ils comprendront que le démantèlement de l’USAID n’est pas seulement mauvais pour les nations en développement—il est mauvais pour les États-Unis eux-mêmes.
Pour conclure, bien que cet article se soit largement concentré sur la perspective américaine, il est utile de considérer les implications plus larges de l’aide américaine au-delà de ses frontières. Comme je l’ai écrit ailleurs (dans un article que je ne peux malheureusement pas partager), l’assistance étrangère des États-Unis—aussi imparfaite soit-elle—n’est pas le méchant souvent décrit, en particulier en Afrique.
Le livre que je lis actuellement, « Looting Machine » de Tom Burgis, expose cela avec une clarté troublante : il n’y a pas de vide. Les nations africaines riches en ressources ne seront pas simplement laissées à elles-mêmes pour comprendre les choses. Si les États-Unis se retirent, d’autres—la Chine, la Russie, même les États du Golfe—interviendront, souvent avec bien moins de scrupules et des intentions bien plus extractives.
Prenez le cas du président Mamadou Tandja du Niger, détaillé dans le sixième chapitre de « Looting Machine ». Lorsqu’il a tenté de résister à l’influence des institutions financières soutenues par l’Occident, d’autres acteurs—notamment la Chine—se sont empressés d’intervenir, offrant des investissements et des prêts, mais à des conditions qui ne profitaient guère à l’ordinaire Nigérien. La réalité est qu’un monde multipolaire ne se traduit pas automatiquement par un monde plus juste et plus prospère—surtout sous une direction inepte.
Pourtant, beaucoup continueront d’être influencés par le journalisme sensationnel et les prises de position idéologiques sur Twitter, réduisant des dynamiques géopolitiques et économiques complexes à des récits simplistes. Mais au moins, nous pouvons ajouter notre propre contribution à cette conversation, offrant une perspective plus nuancée sur pourquoi le démantèlement de l’USAID n’est pas la « victoire » que certains imaginent.
Auteur: Hassane TORO
NB: Le titre est de la rédaction www.lesoleil.bf